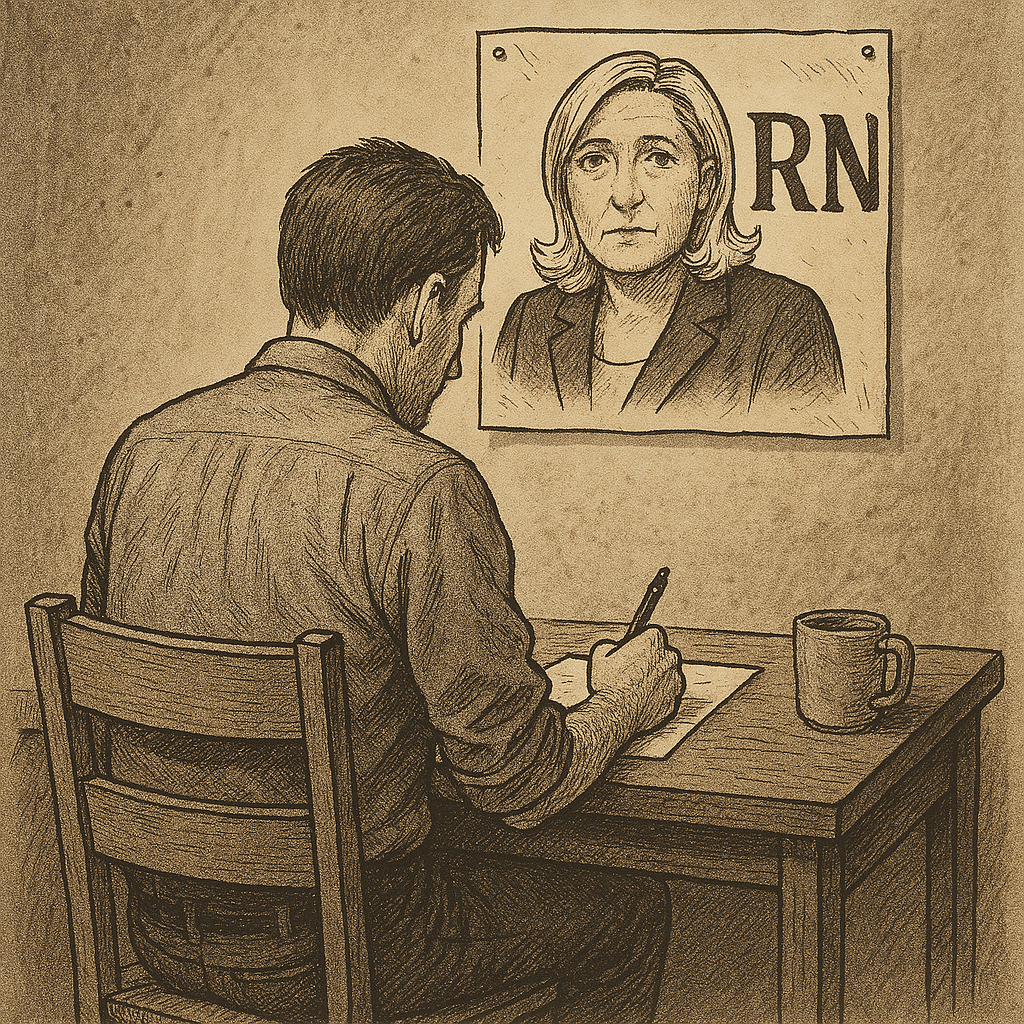Chaque jour dévoile davantage les véritables ambitions d’Israël, qui ne se limitent pas à l’élimination des Palestiniens de Gaza, ni même, peut-être, de Cisjordanie.
Certes, l’idéal d’un État ethniquement homogène, purgé de toute présence étrangère à la foi juive, hante les esprits extrémistes liés au Likoud de Netanyahou.
Des figures comme Itamar Ben Gvir, ministre de la Sécurité nationale et chef du parti sioniste Otzma Yehudit (« Pouvoir juif »), ou Bezalel Smotrich, ministre des Finances et leader de Tkuma (« Résurrection »), rêvent de cette uniformité, voire de la reconstruction du troisième Temple de Jérusalem. Mais un dessein plus vaste se profile : provoquer une réaction iranienne, un casus belli qui, sous prétexte d’une attaque de Téhéran mobilisé pour défendre les Palestiniens, rallierait les États-Unis à une guerre contre cet ennemi désigné. Une tentative s’est esquissée en avril, lorsque l’Iran, en représailles au bombardement de son consulat à Damas par Israël, lança une étrange salve de missiles, heureusement sans grands dommages.
En 1982, un article singulier d’Oded Yinon, conseiller d’Ariel Sharon, parut dans la revue juive Kivunim (« Directives »). Il y exposait une stratégie : déstabiliser les rivaux arabes d’Israël en exploitant leurs fractures ethnico-religieuses, les morcelant en petits États hétérogènes et querelleurs, pour asseoir une hégémonie israélienne au Moyen-Orient.
Tel était le « Plan Yinon », écho du divide et impera des Romains, visant à faire d’Israël une puissance régionale incontestée, libre d’imposer son influence politique, économique et militaire sur ses voisins, sans craindre de rivaux. Les guerres américaines, menées au nom des intérêts israéliens, ont depuis réduit en cendres les principaux États arabes. Ne reste que l’Iran, seule puissance capable de rivaliser militairement et technologiquement avec Israël – bien que ce dernier dispose de l’arme nucléaire, contrairement à Téhéran. L’activisme iranien, drapé d’une posture anti-israélienne, demeure une menace que l’État hébreu ne peut ignorer.
Mais un horizon plus inquiétant se dessine : transposer ce plan à la Russie. En 2019, l’analyste géopolitique anglo-polonais Janusz Bugajski, dans un article intitulé « Management’s Russian Dissolution » publié par The Hill, esquissait cette vision. Les sanctions occidentales, loin d’affaiblir Moscou, auraient convaincu le Kremlin du déclin de l’Occident – un Occident qui, paradoxalement, s’est lui-même fragilisé par ces mesures inefficaces. Bugajski propose une autre voie : exploiter la mosaïque ethnico-religieuse de l’immense territoire russe pour semer la discorde, fragmenter le pays et dresser ses peuples les uns contre les autres. « La Russie n’a pas su se muer en État-nation doté d’une identité ethnique ou civique forte, écrit-il. Elle demeure une construction impériale, héritage de son passé tsariste et soviétique. » Il rêve d’attiser le mécontentement dans les régions les moins russifiées, comme la Sibérie ou le Caucase du Nord, pour qu’elles se soulèvent contre les gouverneurs locaux, nommés par le Kremlin, et exigent leur sécession. « La pression monte à travers le pays, avec une colère croissante contre ces gouverneurs et un ressentiment face à l’appropriation des ressources par Moscou. Des régions comme Sakha ou Magadan, riches en minerais, pourraient prospérer sans l’exploitation de la capitale », soutient-il.
Ce tableau, pourtant, ne résiste pas aux faits. Poutine, plébiscité à plus de 87 % lors des élections de 2024, ne semble guère menacé par des soulèvements. Ce projet relève davantage du fantasme américain que d’une réalité tangible. L’objectif de Bugajski ?
Réduire la Russie à un agrégat d’États insignifiants, inoffensifs, livrant leurs immenses ressources – alimentaires, énergétiques, minérales – au pillage des entreprises occidentales, américaines en tête. Israël, allié indéfectible des États-Unis, s’inscrit dans cette logique néocoloniale, où le vol des richesses d’autrui sert l’hégémonie globale de Washington.
Ce schéma n’est pas nouveau. En 2008, Israël arma et entraîna la Géorgie de Saakachvili – un pion américain façonné pour contrer la Russie – lors de son conflit avec les provinces russophones d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie. Puis vint l’Ukraine, théâtre de révolutions colorées : celle de 2004, dite « orange », et celle de Maïdan en 2014, déclenchée lorsque le président Ianoukovitch suspendit l’adhésion à l’Union européenne – une intégration qui n’a jamais abouti et ne le fera peut-être jamais, pas plus que celle à l’OTAN – pour privilégier des liens avec Poutine, choix logique au vu des affinités culturelles, géographiques et historiques entre les deux nations. Euromaïdan, financé par le Département d’État américain sous Nuland et soutenu par Soros – qui y investit un milliard de dollars en 2015 –, renversa Ianoukovitch. Les nationalistes ukrainiens, dans la foulée, orchestrèrent le massacre d’Odessa.
Les accords de Minsk, signés en 2014 entre la Russie, l’Ukraine et les républiques de Donetsk et Lougansk, promettaient un cessez-le-feu, une démilitarisation et un statut spécial pour ces régions russophones.
Mais Kiev les viola, le bataillon néo-nazi Azov – arborant les symboles de la division SS « Das Reich » – bombardant les civils et interdisant la langue russe. En février 2022, face à l’inaction des États-Unis, qui pilotent le régime de Kiev, la Russie lança son opération spéciale pour protéger ces territoires et rétablir la paix. L’Occident y vit l’avènement d’un « nouvel Hitler », diabolisant Poutine et prêtant à Moscou des visées impérialistes sur l’Europe – une fable bien éloignée de la vérité. Si l’Ukraine doit craindre un voisin, c’est plutôt la Pologne, nostalgique d’une Grande Pologne incluant Lviv, ou la Roumanie, lorgnant la Bucovine.
La Biélorussie de Loukachenko a résisté, mais la Moldavie est désormais dans le viseur. Maia Sandu, façonnée par Harvard et la Banque mondiale, marionnette pro-européenne, s’emploie à couper les ponts avec la Transnistrie russophone, utilisant l’arme énergétique.
« La Moldavie ne dépend plus de la Transnistrie, déclare son ministre des Affaires étrangères, Mihai Popșoi, à Politico le 29 avril 2024. Nous achetons le gaz sur le marché international et construisons des lignes à haute tension vers la Roumanie. » Une folie économique : troquer le gaz russe bon marché contre des prix exorbitants dictés par les spéculateurs, au risque de désindustrialiser et d’endetter le pays, comme tant d’autres vassaux européens de Washington. Cette stratégie vise à provoquer une crise en Transnistrie, à rallier cette région à la Moldavie et à susciter une réaction russe, contrainte de défendre ses frères russophones – une escalade que les élites européennes, muettes ou impuissantes, sauf rares exceptions comme Orbán, laisseraient s’accomplir. Politico évoque un prétendu complot russe pour renverser Sandu, prétexte idéal à un false flag américain: « L’année dernière, les services de renseignement de Kiev ont averti qu’ils avaient intercepté un plan de Moscou visant à organiser un coup d’État et à chasser Sandu, en utilisant un parti d’opposition pro-russe pour renverser le gouvernement ». Espérons qu’il ne réussisse pas.
Ainsi se tisse un nouveau désordre, menaçant d’engloutir l’Europe de l’Est dans le chaos…
Filippo Zicari